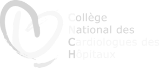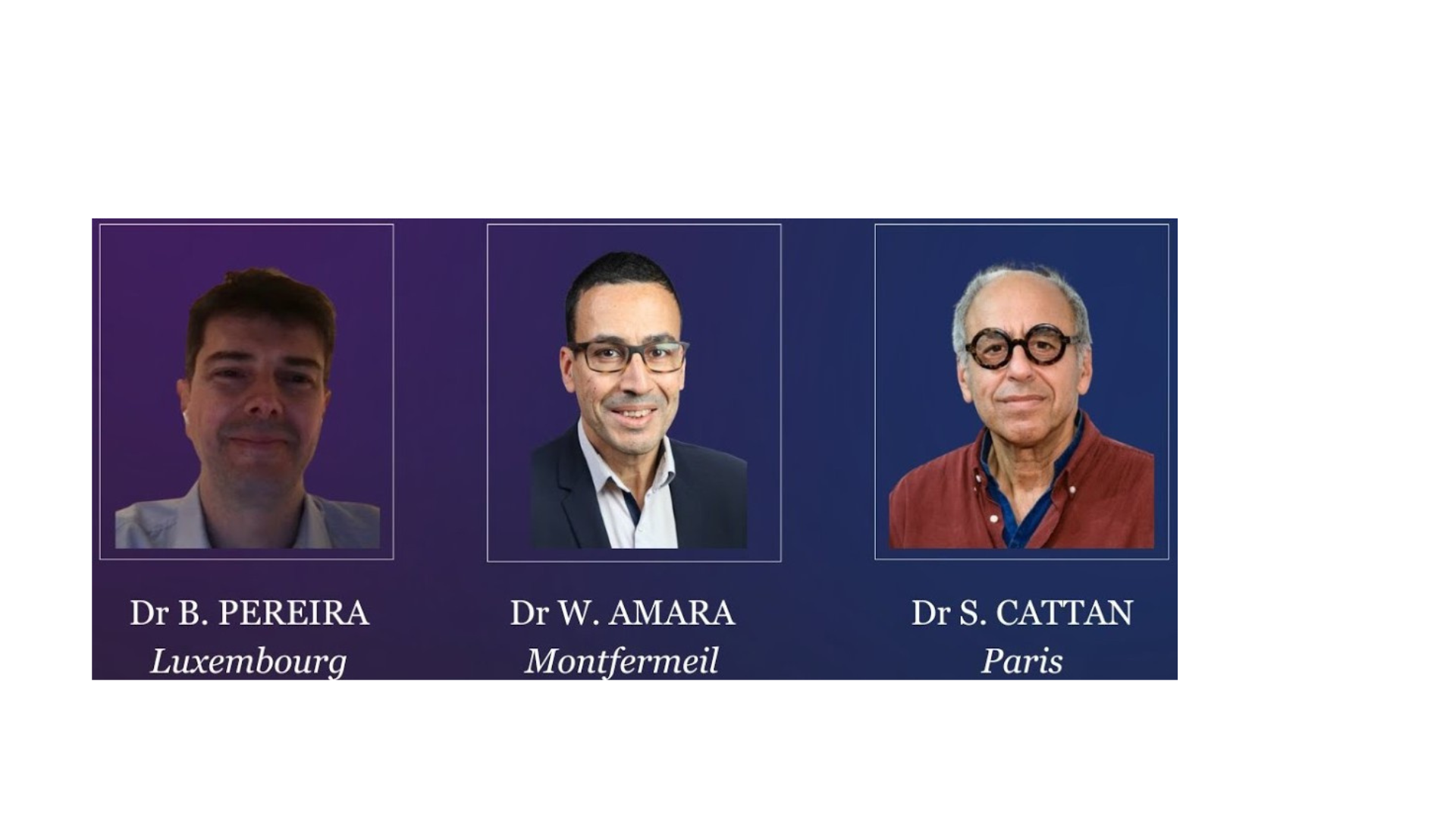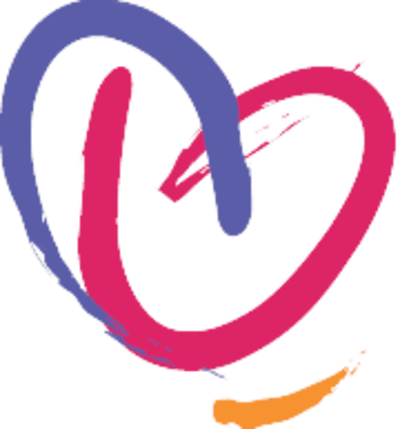M. Francis Saint-Hubert, président de la Conférence nationale des directeurs des centres hospitaliers (CNDCH) - Commission d’enquête relative à l’organisation du système de santé et aux difficultés d’accès aux soins
M. Francis Saint-Hubert, président de la Conférence nationale des directeurs des centres hospitaliers (CNDCH). Je tiens tout d'abord, au nom de l'ensemble des hospitaliers, à remercier sincèrement le groupe LIOT d'avoir utilisé son droit de tirage pour la mise en place de cette commission, qu’il était urgent d’entreprendre. Nous avons examiné attentivement l'ensemble de vos travaux menés jusqu'à présent. Nous sommes véritablement impressionnés par le sérieux de vos questions et votre écoute attentive aux propositions formulées.
La Conférence que je représente regroupe 100 chefs d'établissement représentant l'ensemble des centres hospitaliers, soit environ 800 structures en dehors des CHU. Notre force, mais aussi notre défi, réside dans la grande diversité des centres hospitaliers représentés, allant des plus importants aux plus petits hôpitaux de proximité. Nous sommes fiers d'assurer un maillage complet du territoire.
Diriger un hôpital implique de relever simultanément trois défis majeurs, dont le traitement séparé est souvent source d'échec. En premier lieu, nous devons constamment améliorer la prise en charge de nos patients en garantissant l'égalité d'accès aux soins. Deuxièmement, comme l'a souligné Thierry Godeau, nous devons assurer la qualité de vie au travail, car dans notre secteur plus qu'ailleurs, le bien-être des soignants influence directement la qualité des soins. Enfin, pour renforcer cette qualité de vie au travail, nous devons maintenir nos établissements de santé en bonne santé financière. Ces trois défis sont indissociables et doivent être traités de concert.
Notre rôle est de permettre à l'ensemble des équipes, en première ligne les soignants et les médecins, mais aussi les 130 autres métiers présents dans nos établissements, de remplir leur mission de service public hospitalier. Notre objectif principal reste de soigner, même si l'équilibre budgétaire est une nécessité.
Le système dans lequel nous évoluons, où l'État définit nos missions et nos moyens, est marqué par trois paradoxes majeurs.
Premièrement, nous devons gérer des moyens nécessairement limités face à des missions potentiellement illimitées. Notre système de santé doit permettre un recours aux soins sans restriction.
Deuxièmement, bien que nous ne soyons pas les seuls acteurs de la prise en charge des patients, les règles diffèrent selon les intervenants. Certains cumulent les avantages, comme le paiement à l'acte et le choix des activités, tandis que d'autres cumulent les contraintes, devant tout traiter avec des enveloppes limitées.
Troisièmement, nous devons constamment concilier les enjeux locaux et globaux, les lois étant élaborées pour gérer un système dans sa globalité, ce qui peut parfois créer des tensions au niveau local. Notre système de formation vise l’excellence. Pour autant, elle doit être accessible à tous.
Notre conférence est profondément attachée au service public hospitalier. Certes, nous devons être performants et rechercher l'efficience, mais notre mission va bien au-delà de la simple gestion financière. Un hôpital n'est pas une entreprise où chaque service gère son profit et son activité comme dans un centre commercial. L'interdépendance des services hospitaliers est une réalité incontestable. Par conséquent, cette vision cloisonnée a été particulièrement préjudiciable à nos établissements. Je souhaite aborder trois points essentiels.
Tout d’abord, la circulaire du premier ministre Bayrou évoque, pour la première fois, la restructuration de l'offre sanitaire. Cette réorganisation, que nous attendons depuis longtemps, est aujourd'hui indispensable. En effet, tous les hôpitaux et tous les services ne pourront être maintenus, ce qui revient à faire des choix difficiles mais nécessaires. Que ferons-nous des maternités dangereuses ou des services d'urgence fonctionnant de manière intermittente ? Ces problèmes ne sont que la partie émergée de l'iceberg.
Notre proposition consiste à créer, à l'instar de ce que nous avons fait pour les hôpitaux de proximité, des ensembles homogènes, des matrices d'activité avec différents niveaux pour les centres hospitaliers. Nous devons réfléchir à l'organisation des typologies des CH, en nous inspirant par exemple du modèle des maternités. Il est crucial d'imaginer des ensembles d'hôpitaux répondant à cette graduation des soins.
Deuxièmement, s’agissant du territoire, les coopérations sont essentielles mais ne peuvent être décrétées. Les conflits interpersonnels et les parcours professionnels complexes rendent parfois difficile la collaboration entre équipes. Les GHT, mis en place il y a presque dix ans, doivent évoluer. Nous ne plaidons pas pour un simple GHT. 2, mais pour des GHT de deuxième génération. Certains choix initiaux d’uniformisation, comme le concept d'établissement support au lieu de la personnalité morale, ont montré leurs limites.
Nous proposons de repenser complètement les GHT en imaginant une véritable gouvernance territoriale. L'idée serait de supprimer la vision monolithique actuelle des GHT pour concevoir plusieurs types de groupements adaptés aux réalités locales. Par exemple, des GHT regroupant quelques établissements aux forces et faiblesses complémentaires, d'autres avec un établissement principal et plusieurs structures plus petites, ou encore des GHT incluant ou non des CHU. Il est ainsi impératif de créer des outils, des personnalités morales et des systèmes de gouvernance permettant une prise de décision collective impliquant élus, professionnels de santé et représentants des usagers.
Enfin, le troisième point concerne l'évolution des métiers et de la formation. Nous devons rapidement développer de nouveaux métiers intermédiaires. Le système actuel, dont les formations paramédicales durent de trois à quatre ans et les cursus médicaux de dix à douze ans, n'est plus adapté. Les sages-femmes, qui suivent six à sept ans d’études, constituent un exemple intéressant. Bien que la mise en place du diplôme d’infirmiers en pratique avancée (IPA) représente un premier pas, nous devons aller plus loin dans cette direction.
En conclusion, si la performance et l'efficience sont importantes, la pertinence doit primer. Nous devons notamment repenser la régulation des arrivées aux urgences. Un véritable changement de paradigme s'impose.